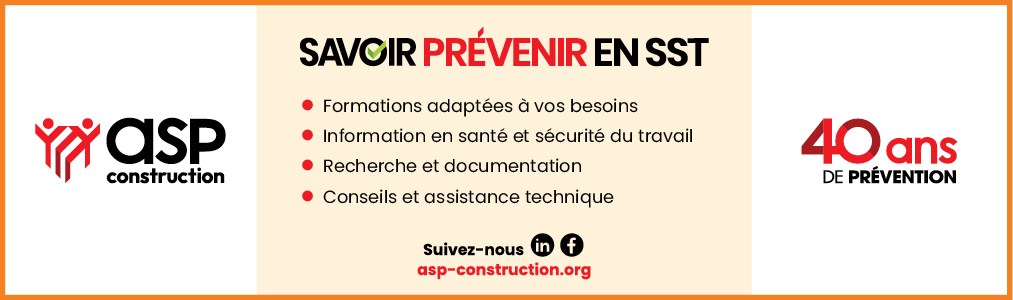Infrastructures végétalisées et grands projets
Des alliées pour inviter l’adaptation aux changements climatiques dans les grands projets d’infrastructures
Longtemps perçues comme accessoires, les infrastructures végétalisées (IV) s’imposent aujourd’hui en tant que solutions incontournables pour améliorer la résilience des territoires face aux grands travaux routiers et d’infrastructures au Québec. Dans un contexte de changements climatiques et d’urbanisation croissante, leur intégration s’avère essentielle pour gérer les eaux pluviales, stabiliser les sols et réduire les îlots de chaleur. Chloé Frédette, conseillère scientifique et chargée de projets à Québec Vert, souligne le potentiel de ces solutions durables et rentables et l’élan grandissant en leur faveur.
par Elsa Bourdot
![]()

Un virage nécessaire pour les infrastructures du Québec
Avec un réseau routier s’étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres, le Québec fait face à des enjeux majeurs en matière d’aménagement et de résilience climatique. Or, depuis quelques années, les infrastructures végétalisées apparaissent comme une réponse efficace aux défis posés par les précipitations extrêmes, l’érosion des sols et la montée des températures.
«L’adaptation aux changements climatiques ne peut pas se limiter à l’amélioration des matériaux utilisés dans les infrastructures. Il faut repenser entièrement notre approche de l’aménagement, et cela passe nécessairement par une meilleure intégration de la végétation, explique Mme Frédette. Dans la nature, la végétation est l’un des principaux facteurs de régulation climatique. En retirant la végétation d’un milieu, on perturbe complètement cette régulation et on perd cette capacité de la végétation à temporiser les impacts des phénomènes climatiques extrêmes».
Un récent inventaire (non exhaustif) mené par Québec Vert recense plus de 800 IV dans 120 municipalités du Québec. Si la majorité des projets sont encore concentrés dans le sud de la province, où les pressions urbaines sont les plus fortes, la tendance s’étend progressivement à d’autres régions, jusqu’au Saguenay et en Gaspésie.

Une végétalisation adaptée aux grands projets routiers
En comparaison avec les toitures et les murs végétalisés, davantage associés aux bâtiments, les IV appliquées aux routes et aux grands aménagements se traduisent par des dispositifs spécifiques.
«Dans les grands projets routiers, on parle surtout de trois types d’aménagements: la gestion des eaux pluviales par biorétention, la stabilisation des pentes et des berges par des plantations adaptées ou le génie végétal, et les brise-vent naturels pour améliorer la sécurité routière», détaille Chloé Frédette.
Les ouvrages de biorétention – incluant les cellules, les noues, les bassins de rétention et autres infrastructures drainantes végétalisées – permettent notamment de ralentir et de traiter les eaux de ruissellement à la source et de les laisser s’infiltrer, réduisant ainsi les inondations et leurs impacts et les risques de surcharge des réseaux d’égout.
«Aujourd’hui, il est inconcevable de créer un projet d’infrastructure routière sans réfléchir à la gestion des eaux. Les techniques végétalisées sont parmi les plus efficaces et durables pour ce faire», insiste l’experte. Elle va plus loin: «Leur avantage majeur est de procurer simultanément plusieurs autres fonctions, ce qu’aucune infrastructure grise ne peut faire. C’est aussi ce qui explique leur rentabilité: chaque dollar investi dans les IV sert à résoudre plusieurs problématiques à la fois.»
Les pentes et talus routiers, quant à eux, peuvent être consolidés grâce au génie végétal, qui remplace les solutions classiques d’enrochement par des techniques de plantation stratégiques. «Les enrochements sont souvent perçus comme la solution la plus simple et la plus efficace, mais ils n’ont aucun bénéfice pour les écosystèmes riverains, qui sont particulièrement importants sur le plan écologique et pour la qualité de l’eau, et le coût environnemental associé à l’extraction et au transport de la roche n’est absolument pas compensé. Les techniques végétales permettent non seulement de stabiliser les sols, mais aussi de recréer des habitats favorables à la biodiversité», précise Mme Frédette.
Enfin, les haies brise-vent jouent un rôle essentiel dans la sécurité des routes hivernales en réduisant l’accumulation de neige et la force des rafales. «Un alignement d’arbres bien positionné peut améliorer considérablement la sécurité routière, notamment en diminuant la quantité de neige recouvrant la chaussée et la perte de visibilité lors de forts vents et de poudreries», ajoute la spécialiste.
Freins et défis liés à l’implantation
Malgré ces avantages documentés, les IV peinent encore à s’imposer comme une norme dans les projets d’infrastructure québécois. Parmi les principaux obstacles identifiés, le manque de formation des professionnels de la conception des aménagements et la perception négative des coûts d’entretien figurent en tête de liste.
«On entend souvent qu’il n’y a pas de budget pour entretenir des infrastructures vertes. Pourtant, les coûts associés à leur entretien sont minimes en comparaison aux économies que ces infrastructures permettent de réaliser. Le problème, c’est que les décideurs sont encore trop souvent enclins à supprimer ces éléments lorsqu’un projet dépasse son budget», regrette Chloé Frédette.
Un autre défi majeur réside dans la formation des ingénieurs, des urbanistes et d’autres professionnels de l’aménagement, qui sont encore trop peu outillés du point de vue des normes et sensibilisés en ce qui concerne ces techniques. «Il reste énormément de travail à faire pour mettre en place les normes et les outils qui vont permettre aux IV d’être largement adoptées. Beaucoup d’ingénieurs diplômés aujourd’hui ne savent pas ce qu’est la biorétention ou le génie végétal ni comment bien concevoir ce type d’ouvrages. Il faut que ça change si on veut une adoption généralisée», insiste-t-elle.
Une volonté politique encore insuffisante
Comparé à l’Europe, où la végétalisation des infrastructures est mieux intégrée aux politiques publiques et aux pratiques des professionnels, le Québec accuse un certain retard. Pourtant, des signaux encourageants émergent.
En septembre 2024, Québec Vert a déposé un livre blanc sur la végétalisation, dans lequel figure une recommandation forte: rendre obligatoire l’intégration d’IV dans les projets d’infrastructure financés à plus de 50% par des fonds publics.
«Nous demandons que tous les grands projets d’infrastructure incluent un minimum de 2% du budget total en végétalisation et que celle-ci ne soit plus considérée comme un élément de décoration, mais bien comme une composante fonctionnelle essentielle. Ce n’est pas juste un coût en plus, c’est un investissement rentable à long terme», plaide Mme Frédette.
Un atout économique et environnemental
Au-delà des gains environnementaux et sociaux, ces infrastructures offrent des bénéfices économiques concrets. En améliorant la gestion des eaux pluviales, elles réduisent les coûts nécessaires au transport et au traitement de ces eaux ainsi que ceux liés aux dommages causés par les débordements du réseau.
Aujourd’hui, il est inconcevable de créer un projet d’infrastructure routière sans réfléchir à la gestion des eaux. Les techniques végétalisées sont parmi les plus efficaces et durables pour ce faire.
— Chloé Frédette
De plus, en réduisant les îlots de chaleur, la végétalisation diminue les besoins en climatisation dans les zones urbaines adjacentes. «Moins de chaleur en ville, c’est aussi moins
de pression sur le réseau électrique, des économies d’énergie considérables et, surtout, des économies sur le plan des
soins de santé, puisque cela réduit substantiellement le taux
d’admission dans les hôpitaux et le taux de décès», souligne Chloé Frédette.
Si le Québec veut accélérer la transition vers des infrastructures plus résilientes, il devra passer d’une approche expérimentale à une intégration systématique de ces solutions. «Nous savons que ces techniques fonctionnent, et les études locales pour les adapter à nos conditions climatiques s’accumulent.
Il est temps de les adopter à grande échelle et d’en faire un standard dans nos projets d’infrastructure», conclut-elle. ■