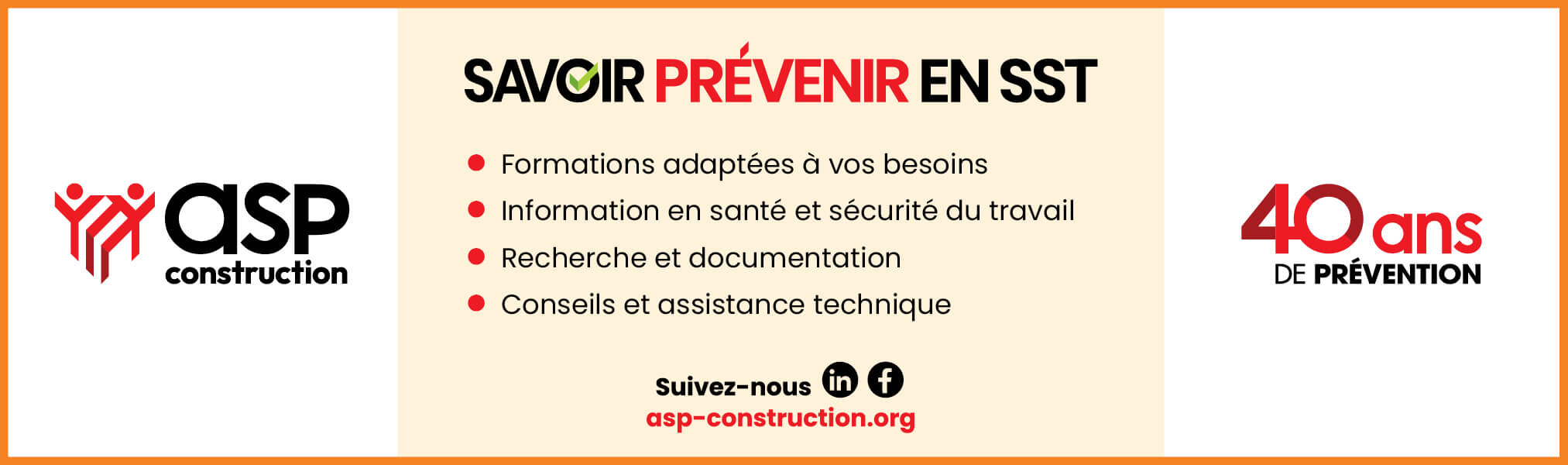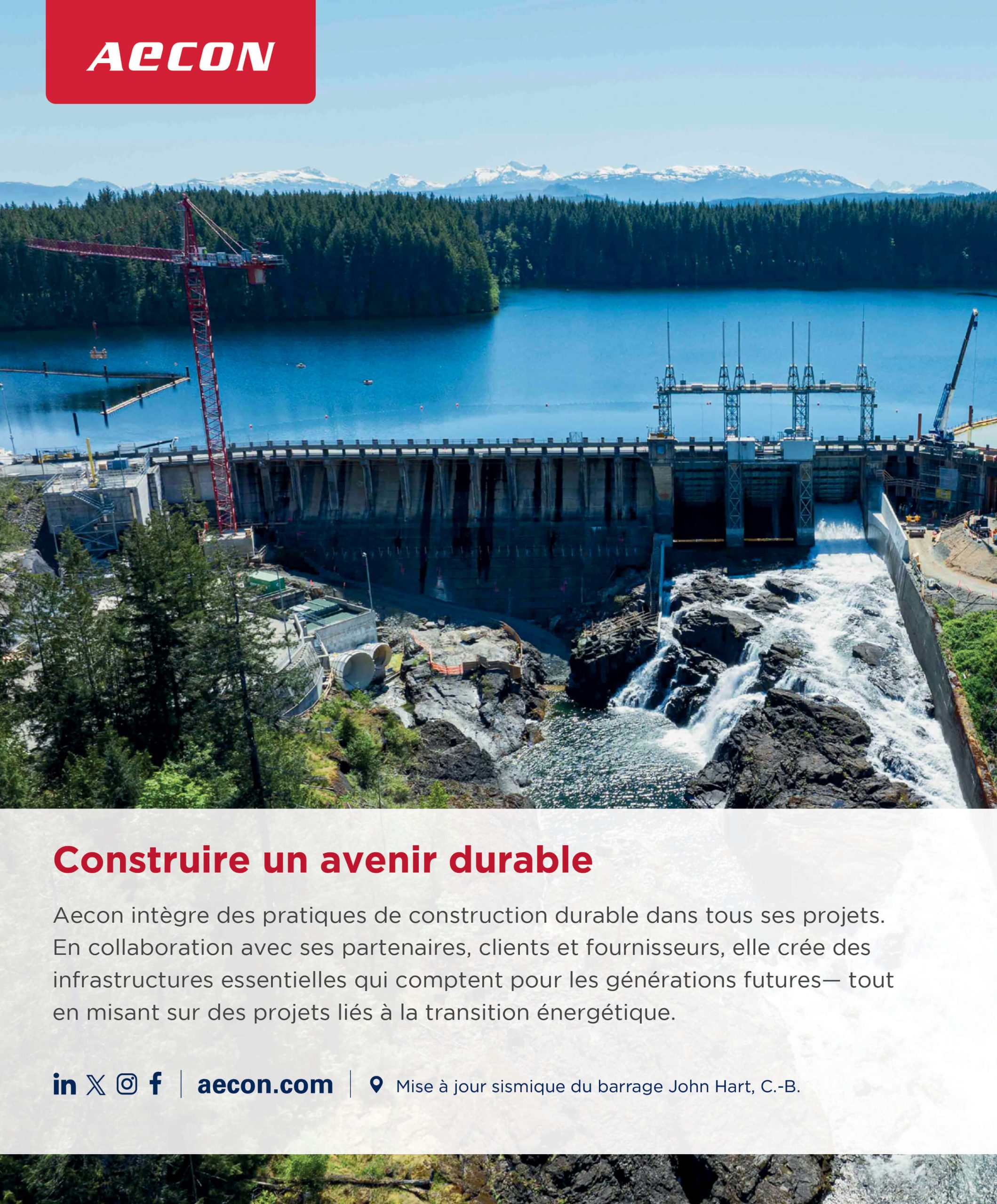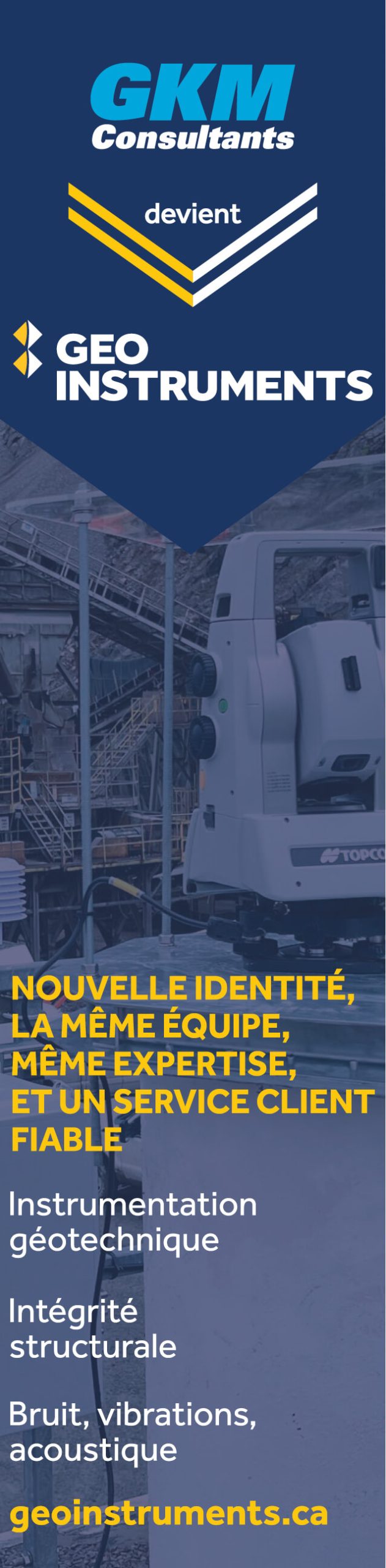Coûts réels du transport : ce que dit l’étude de Mobilité Montréal
Un nouvel outil pour évaluer le coût des modes de déplacement
Afin de mieux informer les collectivités et permettre de tenir compte de certains paramètres dans l’élaboration de politiques publiques, Mobilité Montréal s’est penché sur les coûts et impacts individuels et collectifs associés aux divers modes de déplacement. Les travaux, publiés l’an dernier, se sont penchés sur les coûts sociaux associés aux divers modes de déplacement afin de mieux informer les collectivités et de tenir compte de certains paramètres dans l’élaboration de politiques publiques.
par Leïla Jolin-Dahel
![]()
 «En incluant tous les éléments indirects payés par la collectivité, ça modifie le calcul relatif des coûts reliés aux différents types de transports», résume David Benatia, professeur agrégé au Département d’économie appliquée à HEC Montréal et co-
«En incluant tous les éléments indirects payés par la collectivité, ça modifie le calcul relatif des coûts reliés aux différents types de transports», résume David Benatia, professeur agrégé au Département d’économie appliquée à HEC Montréal et co-
auteur de l’étude.
«Sans ces composantes supplémentaires, ça peut avoir l’air de ne pas être si cher de prendre sa voiture. Mais si l’on tient compte de tous les facteurs, ça peut devenir très conséquent. L’idée était de mettre cela en lumière.» Ainsi, des facteurs tels que les émissions de gaz à effet de serre (GES) en contexte de changements climatiques et leurs répercussions sur la santé des gens ont été considérés dans l’évaluation des chercheurs.
Ces facteurs comportent également les coûts privés, soit ceux associés à la possession d’une voiture. Ils comptent notamment les frais liés à l’achat ou à la location, à l’entretien et à l’utilisation d’un véhicule comme le carburant, les contraventions, le stationnement, l’immatriculation, ou à l’utilisation d’un service de transport en commun.
L’étude a aussi considéré les coûts sociaux, qui incluent ceux de nature publique et externe. Les premiers relèvent des instances gouvernementales. Ils comprennent la construction et l’entretien des infrastructures routières et de mobilité urbaine, de même que le déneigement. De leur côté, les coûts externes s’appliquent entre autres aux émissions de GES, aux accidents, à l’occupation de l’espace et à la congestion.
Ainsi, pour chaque dollar dépensé, les cyclistes et les piétons font économiser respectivement 0,12$ et 0,01$ en coût social. À l’opposé, les automobilistes font débourser 1,55$, tandis que, pour les personnes utilisant les systèmes de déplacement collectif, ce montant équivaut à 0,49$.
Des régions délaissées
Comme les transports collectifs et les infrastructures cyclables et piétonnes sont davantage développés dans les centres urbains, il en résulte donc des disparités d’options et de coûts. Et ce, au désavantage des personnes résidant en banlieue et se rendant en ville pour le travail.
Des mesures comme le covoiturage peuvent engendrer de grandes diminutions de l’empreinte carbone.
— David Benatia
«C’est plus facile de créer des initiatives pour décarboner dans les grandes villes parce que la densité de population est plus importante, explique M. Benatia. Le système de déplacement en commun devient rentable dans un endroit où il y a
suffisamment de gens qui en bénéficient. On ne pourrait pas construire un métro dans les Laurentides.»
Ainsi, le transport collectif et actif est surtout implanté dans les municipalités où le coût d’abattement de la pollution et des émissions de GES est plus faible. «Ça ne veut pas dire que ce n’est pas important de le faire aussi ailleurs. Mais ça revient sans doute plus cher, et il faut faire preuve de créativité.»
Décarboner, même en milieu rural
Dans le but d’assurer la transition énergétique du transport, deux leviers principaux existent, résume le professeur. Le
premier consiste en des moyens pour encourager la population à moins faire usage de son véhicule. «Des mesures comme le covoiturage peuvent engendrer de grandes diminutions de l’empreinte carbone.»
Sur le plan des collectivités, le développement d’infrastructures de transport en commun et actif permet aussi de réduire le recours à l’auto solo. Ainsi, un service fiable et régulier inciterait davantage de personnes à l’utiliser.
Le chercheur a également constaté que le frein essentiel à la mobilité active était l’absence de réseau sûr. «Beaucoup de gens qui vivent dans les régions autour de Montréal font de petits trajets pour aller travailler. Or, leur itinéraire n’est pas toujours sécuritaire pour les parcours à bicyclette ou, encore, il y a peu ou il n’y a pas d’autobus. Donc, ils n’ont d’autre choix que de prendre leur véhicule.»
M. Benatia estime qu’aménager adéquatement les voies cyclables ou piétonnisées inciterait davantage de personnes à délaisser leur voiture au profit des déplacements actifs. «Évidemment, tout le monde n’est pas aguerri pour s’adonner au vélo d’hiver, mais il y a quand même beaucoup de saisons dans l’année où l’on peut faire cinq kilomètres en pédalant.»
En optant pour la mobilité décarbonée, les automobilistes pourraient par ailleurs voir chaque année leurs dépenses chuter de 3 530$ en coûts privés et de près de 10 130$ en coûts sociaux. À l’échelle de la société, cela engendrerait 1,7 G$ d’économies. Une transition qui aurait également pour effet de réduire les émissions de GES de 21%, de baisser la congestion routière de plus de la moitié et d’éviter 46% des accidents.
M. Benatia et ses collègues espèrent que les résultats de leurs recherches donneront l’occasion aux instances gouvernementales de mieux orienter la planification urbaine en misant sur des approches durables. «Après la publication de nos travaux, on a été contactés par plusieurs municipalités entourant Montréal, qui voulaient comprendre ces défis et trouver des solutions.»
En tenant compte des coûts invisibles associés au transport, d’autres études à travers le Québec pourraient donc dresser un portrait de la situation à plus grande échelle. ■