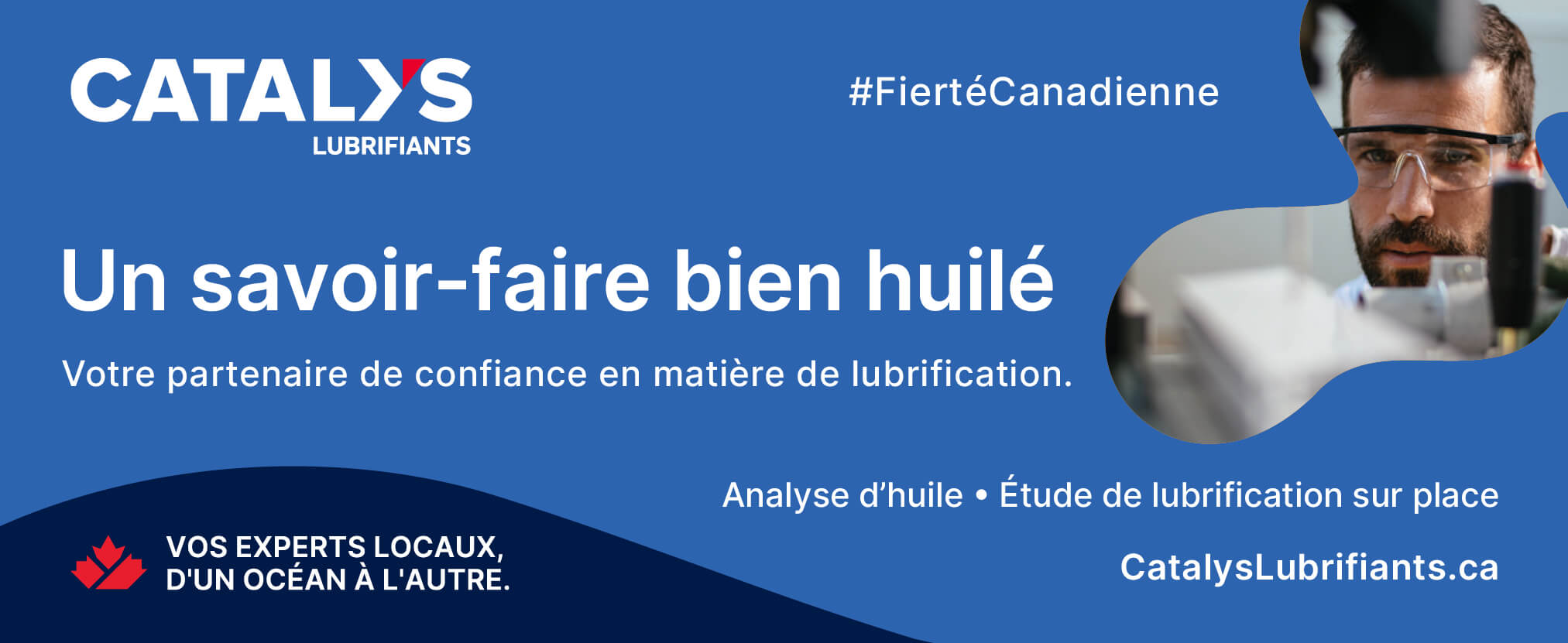Du tramway au REM: 150 ans de mobilité dans le grand Montréal
Un regard historique sur les avancées qui permettent aux gens de se déplacer
Des tramways au Réseau express métropolitain (REM), l’offre en transports dans le grand Montréal a évolué non seulement au fil des décennies et des technologies, mais aussi en fonction de l’étalement urbain.
par Marie-Ève Martel
![]()


Le transport en commun fait bouger Montréal depuis le milieu du 19e siècle. À l’époque, on voyait des tramways tirés par des chevaux, remplacés par des tramways électriques au tournant de 1900. Entre-temps, les autobus sont apparus sur les routes. C’était il y a un peu plus d’un siècle.
Période d’expansion
La fin des années 1950 et le début des années 1960 entraînent un essor des projets de construction, notamment grâce aux nouvelles façons de construire avec du béton.

«C’est une période charnière parce que c’est là qu’émergent les premières grandes planifications urbaines avec des objectifs clairs en termes d’aménagements, de fonctions et de transport, relève Florence Junca-Adenot, professeure associée au Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM et spécialiste en transport urbain. C’est le moment où les grands travaux d’infrastructure s’amorcent: le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le premier pont Champlain, et le réseau d’autoroutes.»
En parallèle, le gouvernement encourage l’accès à la propriété des Québécois, qui sont à l’époque locataires en grand nombre. On s’inspire du rêve américain, dans lequel chaque famille possède une maison, une piscine, une voiture. Un mouvement qui donne naissance aux banlieues.
«Tout tournait autour de la voiture, nuance la spécialiste. Les autoroutes ont été construites près des lignes de train de banlieue, qui ont fini par disparaître.»

Le trou de beigne urbain évité
En vue de l’exposition universelle qu’elle accueillera en 1967, la Ville de Montréal entreprend la construction de son métro au milieu des années 1960.
«Pour le maire Jean Drapeau, il fallait transporter tout le monde sur l’île Sainte-Hélène à partir de l’île de Montréal: on ne pouvait pas seulement compter sur les voitures avec les millions de personnes attendues», indique Mme Junca-Adenot.
Le réseau souterrain est pensé de manière à relier les zones déjà construites de la métropole et les plus densément peuplées.

«Drapeau était très au courant du phénomène du “beigne urbain” aux États-Unis, c’est-à-dire que les centres-villes se sont dépeuplés au profit des banlieues, les bâtiments se sont vidés, et la violence s’est installée, détaille la professeure. Montréal a échappé à ce phénomène parce que son réseau de métro a permis de garder le centre-ville vivant et fructueux.»
Les grands projets autoroutiers des années 1960, jumelés au désir de Québec d’encourager la propriété, donnent naissance aux banlieues.

Densification périurbaine
Le développement du métro a aussi contribué à consolider le réseau d’autobus. «Ça prenait des réseaux d’autobus pour alimenter les stations [de métro], renchérit Florence Junca-Adenot. Tout a été organisé pour aller au centre-ville.»
Dans les années qui ont suivi, les municipalités en périphérie de Montréal ont continué d’accueillir de plus en plus de citoyens, même si le centre-ville métropolitain demeurait le principal pôle d’emploi de la population.
«Dès le milieu des années 1990, il y a plus d’habitants à l’extérieur de l’île que sur celle-ci, et la congestion automobile augmente», ajoute la spécialiste en transport urbain, qui a siégé à la commission Pichette sur la gouvernance métropolitaine avant de diriger l’Agence métropolitaine de transport dès sa fondation en 1996.
Comme gestionnaire, elle a relancé les trains de banlieue. «J’avais un objectif très clair de m’attaquer à l’auto solo et de faire croître l’utilisation du transport collectif», explique-t-elle.


Gagner de l’espace
Selon Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, «le principal objectif du transport en commun est de gagner de l’espace».
«Les statistiques caricaturent bien le phénomène: avant la pandémie, environ 300 000 travailleurs convergeaient tous les jours vers le centre-ville de Montréal. Parmi ceux-ci, seul un sur quatre s’y rendait en automobile, illustre le professeur. Alors quand on va au centre-ville et qu’on trouve que c’est compliqué parce qu’il y a trop de voitures, imaginons si 100% des personnes qui se rendaient sur l’île étaient venues avec la leur. Ça serait encore plus dense!»
La densité de la population est ce qui justifie le développement du réseau de transport en commun. «C’est quand on densifie beaucoup qu’il devient incontournable, parce qu’on se demande où on va mettre les voitures», explique M. Meloche.
La densité explique également pourquoi le transport en commun se déploie différemment dans les régions périphériques, malgré l’étalement urbain des dernières décennies.
«Jusqu’à une certaine époque, on pensait que l’étalement urbain vers la banlieue était un choix personnel, un mode de vie, indique M. Meloche. C’est par la suite qu’on a réalisé que les personnes qui vivent en banlieue occupent des espaces à plus faible densité, utilisent davantage leur voiture, génèrent plus de GES et se retrouvent prises dans la congestion.»
Ainsi, si la demande en service n’est pas suffisamment grande pour rentabiliser l’offre, les décideurs choisiront de ne pas y répondre.
C’est pour cette raison que le transport en commun est orienté des banlieues vers les centres urbains et qu’il existe peu de lignes intermunicipales entre les municipalités de moindre envergure.
«Pour les gens en périphérie, qui vivent dans des quartiers aménagés pour l’automobile, ça n’est pas rentable ni idéal de développer des lignes d’autobus, poursuit le professeur. Ces personnes habitent tellement loin les unes des autres qu’il faudrait de très longs circuits pour remplir les autobus; ce n’est pas efficace.»
«Tout a été développé autour de l’automobile, et du jour au lendemain, on dit aux gens: vous devez prendre l’autobus.»
J’avais un objectif très clair de m’attaquer à l’auto solo et de faire croître l’utilisation du transport collectif.
— Florence Junca-Adenot

Quand la politique devance la planification
La construction du pont Samuel-De Champlain, pour remplacer le pont Champlain en fin de vie, a permis la naissance du REM, qui remplace aujourd’hui l’équivalent des 350 autobus qui circulaient sur son tablier en heure de pointe quotidiennement.
Il s’en est fallu de peu pour que le métro léger automatisé voie le jour, indique Florence Junca-Adenot. «Au moment de planifier la construction, le fédéral a demandé à Québec et à l’AMT ses plans, relate-t-elle. Le gouvernement a tataouiné, et à la dernière minute avec la Caisse de dépôt et placement on a décidé de faire le REM.»
L’idée d’aménager une troisième phase, vers l’ouest de l’île, plutôt que vers l’est, est une «décision purement politique. Ce qui se passe, c’est exactement comme avec le réseau routier. On construit, tout simplement, déplore-t-elle. Ça ne répond pas à une stratégie de développement, il y a eu zéro plan d’aménagement, aucune réflexion sur les futurs développements.»
Et maintenant?
D’ici 2050, la région métropolitaine comptera plus de
4,85 millions d’habitants, soit environ 650 000 personnes de plus qu’aujourd’hui. Si cette tendance se poursuit, cette croissance générera un million de déplacements supplémentaires en voiture quotidiennement.
Pour bien répondre aux besoins des citoyens en maximisant l’utilisation du transport en commun, la solution résiderait donc dans l’aménagement et la construction de plus petits centres urbains, plus denses, qui seraient reliés entre eux.
«C’est ce qu’on voit avec l’essor de Laval, qui prendra de l’ampleur dans les prochaines années, comme on l’a vu à Longueuil et à Brossard, qui jouit d’une densité impressionnante, indique Jean-Philippe Meloche. Du moment où vous avez des pôles qui se créent, les gens peuvent prendre le transport en commun pour aller au centre-ville, faire des courses et revenir.»
«Si on veut donner un boost au transport en commun, il faut travailler l’aménagement du territoire pour densifier, pour créer des secteurs multifonctionnels où les gens pourront vivre, travailler et consommer des biens et services», conclut Florence Junca-Adenot. ■